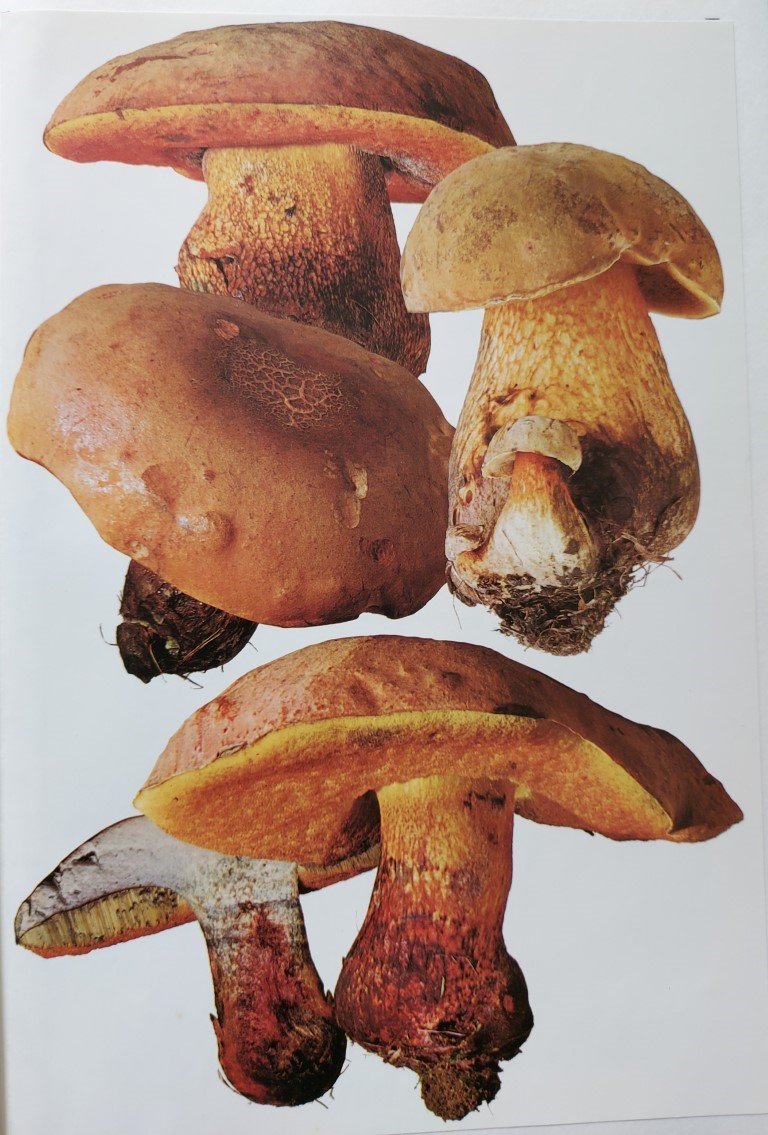14 mars 2024 |
Il existe de nombreuses espèces de sumac. Seules les baies de 3 d’entre elles peuvent être utilisées en cuisine: le sumac des corroyeurs (Rhus coriaria), le sumac de Virginie (Rhus typhina), ainsi que le sumac vinaigrier glabre (Rhus glabra). Le sumac que l’on achète comme épice provient de Rhus coriaria.
Rhus typhina: originaire d’Amérique du Nord. A été planté en Europe comme plante ornementale, où il est devenu une espèce invasive. Adapté aux climats froids et humides. C’est l’épice que l’on nomme « sumac sauvage ». Il est moins acide que le sumac du Moyen-Orient.
Rhus coriaria: originaire du Moyen-Orient, de l’Asie centrale, de l’est de la Méditerranée. Adapté aux climats chauds et secs, terrains calcaires et caillouteux. C’est l’épice « sumac » que l’on consomme couramment.
Le sumac provenant de Rhus coriaria est de couleur rouge foncé. Il a un effet salant, un goût piquant, acide et fruité, qui perd en intensité à la cuisson sous l’effet de la chaleur. Peut remplacer le citron ou le vinaigre. Dans les plats mijotés, on l’ajoutera de préférence en fin de cuisson.
Utilisations des baies en cuisine
Au Liban et en Syrie on l’utilise pour parfumer poissons et fruits de mer.
En Irak et en Turquie dans les salades, boulettes de viande.
En Iran il aromatise le riz et les boulettes de viande hâchée.
En Grèce dans l’Antiquité il était employé pour remplacer le citron et le vinaigre.
Il peut servir à aromatiser le riz, les légumes.
Il entre dans la composition du zahtar ou za’tar, un mélange d’herbes et d’épices libanais (thym, graines de sésame…).
Utilisée dans la fattouche, salade acidulée.
Utilisation des feuilles, écorce
Les feuilles de sumac, riches en tanin, sont utilisées pour le tannage du cuir. Le nom de « corroyeur » vient de là, le corroyeur étant la personne qui traite le cuir tanné et l’amène à l’état de cuir fini.
L’écorce, les racines et les fruits sont utilisées pour leurs propriétés tinctoriales.
L’écorce donne un pigment jaune à jaune-orangé.
Les racines donnent un pigment brun.
Les fruits donnent un pigment rouge.
Identification
Pousse en France, Suisse (Rhus coriaria pousse en région méditerranéenne: en Sicile, en Turquie, dans les pays du Proche ou du Moyen-Orient, Asie, mais normalement pas en Suisse).
5-8 m de hauteur.
Feuilles:
- plus longues que celles de Rhus coriaria;
- folioles allongées et étroites, plus longues et plus nombreuses que celles de Rhus coriaria;
- le rachis (genre de tige entre les folioles) n’a pas d’aile. (le rachis de Rhus coriaria est ailé, élargi en aile étroite, au moins vers le haut de la feuille);
Fleurs:
- floraison de juin à juillet;
- fleurs de couleur blanc-verdâtre-jaunâtre
Fruits:
- été – automne
- rouges et duveteux
Comment fabriquer le sumac « sauvage » – épice?
Récolter les baies au milieu ou vers la fin de l’été (août septembre), quand les fruits ont atteint leur couleur maximale, avant qu’elles ne soient infestées d’insectes et ne moisissent. Si on les récolte tardivement, on prendre garde de ne prendre que les grappes bien rouges (pas celles qui sont devenues brunes). Ne pas cueillir par temps pluvieux, car l’acide malique responsable d’une partie de la saveur est contenue dans les poils qui disparaissent avec la pluie. Se munir si possible de gants, la sève pouvant provoquer des dermites et allergies cutanées.
Egrener pour ne récolter que les baies sans les tiges.
Faire sécher durant 3 à 4 semaines.
Passer les baies au hachoir électrique jusqu’à ce que le fruits soit bien séparés des graines (les graines apparaissent bien claires).
Passer au travers d’une passoire ou d’un tamis pour ne conserver que les parties rouges sans les graines.
Laisser sécher la poudre obtenue 1 ou 2 jours.
Passer le sumac au moulin à café pour obtenir une poudre bien fine.
Se conserve 2 ans en pot à l’abri de l’humidité.


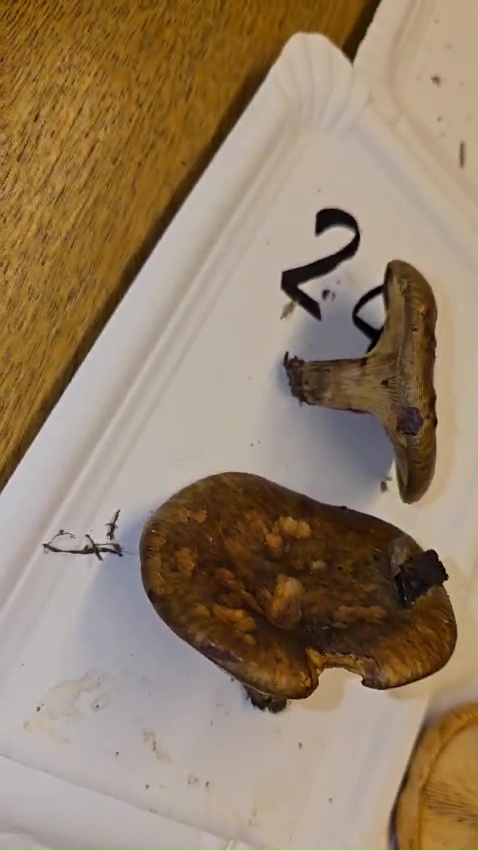





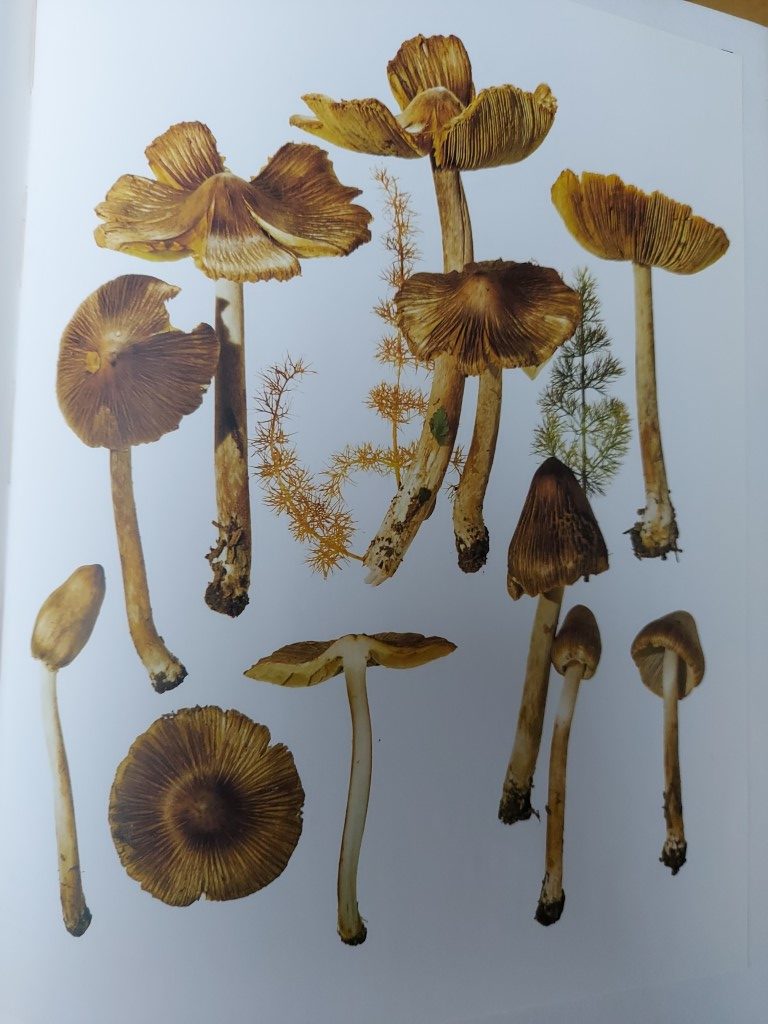









 Pour retirer facilement les baies vertes impropres à la consommation de votre cueillette, recouvrir les baies de sureau d’eau. Les baies n’étant pas mûres vont flotter à la surface, elles pourront alors facilement être enlevées.
Pour retirer facilement les baies vertes impropres à la consommation de votre cueillette, recouvrir les baies de sureau d’eau. Les baies n’étant pas mûres vont flotter à la surface, elles pourront alors facilement être enlevées.